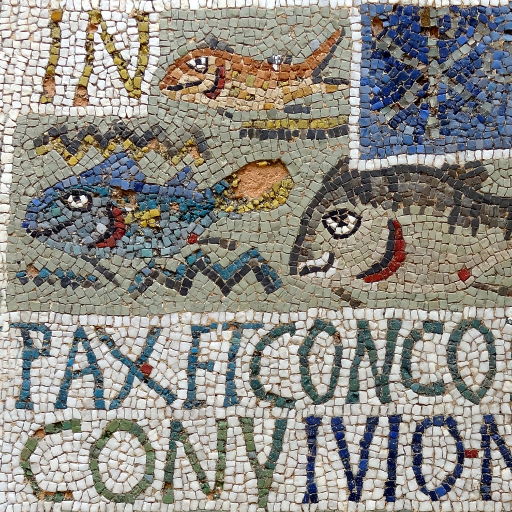Abdelkader Aoudjit enseigne la philosophie aux États-Unis. La conférence qu’il nous a proposée offrait une lecture poststructuraliste de romans algériens des années 1950, à partir d’auteurs comme Jacques Derrida, Michel Foucault et surtout sur Jean-François Lyotard qui propose le terme DIFFEREND pour signifier l’absence d’un langage commun entre des interlocuteurs.
Dans le roman algérien, le différend se trouve entre le langage du pouvoir colonial et celui du peuple colonisé. Cela se manifeste de différentes manières :
Le colonisé n’est pas exprimé dans le langage colonial : c’est comme s’il n’existait pas comme individu. Au mieux il est évoqué dans un collectif « les indigènes ».
Il est aussi nié dans son contexte et ses valeurs : le discours colonial n’y fait pas référence. Contexte et valeurs sont ceux de la mère patrie.
Enfin, le colonisé ne peut trouver dans le discours colonial de quoi donner sens à son existence, car celle-ci lui est niée.
Comment alors retrouver un langage commun ? C’est impossible à partir du discours existant. Il est nécessaire de changer de paradigme. C’est ce que nous pouvons constater aussi dans les discours entre belligérants: l’autre n’existe pas dans le discours de l’un, et réciproquement. Cette perspective est donc très actuelle dans un monde où nous avons du mal à nous parler parce que nos discours ne laissent que peu de place à l’existence de l’autre et à son ex- pression comme individu.
Christophe Ravanel