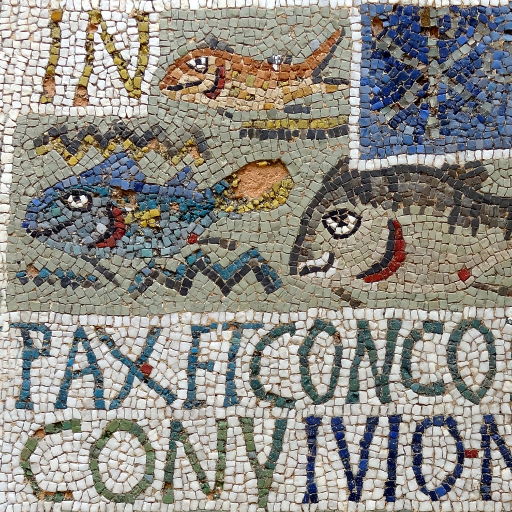Dans une lettre envoyée en 1076 à al-Nāṣir ibn ʿAlannās ibn Ḥammād, souverain de la dynastie berbère des Ḥammādides dont la capitale était Béjaïa, le pape Grégoire VII soulignait déjà que la charité mutuelle entre chrétiens et musulmans devait servir d’exemple aux autres communautés. Après avoir reconnu que Dieu avait inspiré à al-Nāṣir d’agir avec bonté envers la communauté chrétienne locale, le pape Grégoire VII poursuit en disant que Dieu est satisfait lorsque les hommes, en plus d’aimer Dieu, aiment leur prochain et ne font pas à autrui ce qu’ils ne veulent pas qu’on leur fasse. Il affirme alors que les chrétiens et les musulmans doivent montrer de manière particulière aux autres peuples l’exemple de cette charité mutuelle, « nous qui confessons et reconnaissons, bien que de façon différente, un seul Dieu, et qui le vénérons et le louons chaque jour comme créateur des siècles et maître de ce monde »1.
Près de mille ans plus tard, je trouve ces mots du pape Grégoire VII toujours pertinents et actuels, car ils représentent le défi qui se pose encore aujourd’hui aux chrétiens et aux musulmans. Quelle que soit la façon dont nous confessons et reconnaissons le Dieu unique, notre croyance monothéiste commune et notre adoration quotidienne de Dieu, « créateur des siècles et maître de ce monde », exigent que nous devenions, dans notre manière de nous traiter les uns les autres, un exemple d’amour et d’amitié pour l’ensemble de la famille humaine. Autrement dit, tout en reconnaissant que les disciples du Christ et les fidèles de l’islam parlent de Dieu de manière différente, le pape Grégoire VII estimait que ce que nous avons en commun devrait nous pousser à la charité mutuelle et, par là même, devenir un modèle pour les autres. Mais, hélas, nous, chrétiens et musulmans, n’avons que trop rarement reconnu ce devoir religieux que nous avons les uns envers les autres, de même que notre responsabilité éthique commune envers la famille humaine. Nous avons transformé nos divergences doctrinales en obstacles insurmontables qui nous empêchent de collaborer, voire justifient l’animosité.
Ces dernières années, certains chrétiens et musulmans engagés dans le dialogue ont eu tendance à se concentrer sur ce que nous avons en commun, tout en minimisant nos différences. Cette approche peut constituer une première étape nécessaire dans des situations marquées par des tensions et des rivalités interreligieuses. À long terme, cette approche risque toutefois d’aliéner les croyants des deux traditions, car elle tend à ignorer les croyances et pratiques distinctives qui sont au cœur de l’identité chrétienne et musulmane et qui rendent chaque tradition « unique », précisément parce qu’elle est différente des autres.
D’autre part, l’expérience nous enseigne que lorsque les chrétiens et les musulmans entrent en dialogue dans le but immédiat de « prouver » à l’autre qu’il a tort parce qu’il ne partage pas leurs croyances les plus chères, une telle tentative conduit rapidement à une impasse qui bloque la relation. C’est pourquoi, avant d’aborder nos divergences doctrinales, nous devrions d’abord cultiver l’amitié et la confiance mutuelle, devenir des hôtes spirituels les uns des autres et reconnaître les valeurs que nous découvrons dans l’expérience religieuse de l’autre, des valeurs dignes de respect et même d’admiration spirituelle. Cet exercice nous fournira une base solide pour construire la « culture de la rencontre », comme l’appelait de ses vœux le pape François, qui seule rendra possible la coexistence pacifique et amicale entre nos deux communautés, voulue par Dieu.
Alors, en renforçant les liens qui nous unissent et en assumant chaque jour un peu plus notre vocation commune à devenir un modèle de fraternité pour l’humanité entière, nous, chrétiens et musulmans pourrons parler ouvertement de nos divergences, même dans les domaines où nos théologies nous semblent incompatibles, sans pour autant mettre en péril notre amitié. Comme l’a dit le pape François à Rabat, le 30 mars 2019, « il s’agit de découvrir et d’accueillir l’autre dans la particularité de sa foi et de s’enrichir mutuellement de la différence, dans une relation marquée par la bienveillance et la recherche de ce que nous pouvons faire ensemble ».
Diego Sarrió Cucarella, évêque de Laghouat-Ghardaïa
9 juillet 2025
1 Trad. d’après Christian Courtois, « Grégoire VII et l’Afrique du Nord. Remarques sur les communautés chrétiennes d’Afrique au XIe siècle », Revue Historique 195 (1945), p. 97-122 et 193-226.